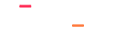La tragique histoire du Palmier de Rapa Nui
Modifié le :

Article rédigé par
BORIS PRESSEQ, Botaniste au Muséum de ToulouseOU LA DISPARITION D’UN ARBRE ENDÉMIQUE DE L’ÎLE DE PÂQUES ET UNE FABLE VÉRIDIQUE À MÉDITER POUR NOTRE ÉPOQUE ET À UNE AUTRE ÉCHELLE

L’Île de Pâques, Rapa Nui en rapanui, langue polynésienne, est une petite île d’origine volcanique perdue au milieu du Pacifique à 23° de latitude sud, éloignée de 3 500 km du Chili à l’Est et de plus de 2 000 km des Îles Pitcairn à l’Ouest. Connue notamment pour ses nombreuses statues monumentales, les moaï, elle fait depuis longtemps l’objet de conjectures sur le déclin de sa végétation forestière originelle.
L’île, dont la surface est de 163 km², a la forme d’un triangle dont les trois pointes sont occupées par trois volcans éteints coalescents. La surrection de ces volcans a eu lieu entre 780 000 et 410 000 années avant notre ère et les dernières grosses coulées de laves se sont écoulées il y a environ 110 000 années. Son plus haut sommet culmine à 507 mètres.
Étant donné le caractère volcanique de l’île, la végétation y a été apportée par les vents, les courants océaniques et les oiseaux marins, et ne s’est définitivement implantée, probablement, que longtemps après les dernières grandes coulées de lave.
Le premier peuplement humain de Rapa Nui est daté aux alentours de l’an mil. Il est le fait de populations d’origine polynésienne arrivées par voie maritime. Lorsque les premiers Européens débarquent sur l’île en 1722, ils constatent que Rapa Nui est largement déboisée et, s’il y pousse quelques arbustes épars, aucun des scientifiques présents parmi les équipages ne note l’existence de palmiers dans le paysage. Le cocotier, Cocos nucifera, bien présent partout en Polynésie, ne se trouve pas non plus sur Rapa Nui malgré un climat subtropical et la présence de quelques milieux côtiers où il aurait pu se développer.
Or, les prospections archéologiques de ces dernières décennies et les études de pollens ont mis en évidence et validé l’existence sur l’île d’une espèce de palmier aujourd’hui éteinte. Les fouilles les plus récentes ont également permis de découvrir les empreintes des bases et racines de ce palmier disparu et d’estimer sa densité : avant l’arrivée des premiers habitants polynésiens, l’île était vraisemblablement couverte de près de 16 millions de palmiers !
De quel palmier s’agit-il ?
En 1955, des fouilles dans les sédiments des cratères du Rano Raraku et du Rano Kau ont mis au jour de grandes quantités de pollens de palmier. Dans cette grande famille de plantes, l’ornementation des grains de pollen caractérise assez bien au moins le genre. La morphologie des grains de pollen examinés ici les apparente sans nul doute au palmier du Chili, Jubaea chilensis, endémique et toujours présent au Chili.

Des empreintes laissées dans le sol par les racines et les bases des tiges des palmiers sont trouvées lors de fouilles archéologiques récentes. Ces racines, cylindriques et non ramifiées, parfois de l’épaisseur d’un petit doigt, laissent en se désagrégeant un vide de section circulaire dans le sol. Comme elles naissent toutes de la base du palmier, à l’endroit où celui-ci a disparu, on a une concentration de trous circulaires de même diamètre et une dépression circulaire due à la forme de la base du palmier.
Mais les pollens et les empreintes de racines ne sont pas assez caractéristiques, seuls les endocarpes vides et abîmés de fruits retrouvés dans des cavités sur le site Ana Okeke sur la péninsule de Poike ont servi à décrire ce genre et cette espèce. Ces fruits, qui ressemblent à des noix de coco miniatures, rattachent sans difficulté le palmier de Rapa Nui à la tribu des Cocoseae dans la grande famille des Arecacées, comme le Jubaea, mais ils sont subtilement différents des fruits de ce dernier. N’ayant aucun autre reste à se mettre sous la loupe (pas même une empreinte de feuille) il a fallu se résoudre à créer un nouveau genre, et le palmier de Rapa Nui a été nommé Paschalococos disperta par J. Dransfield en 1983.
Des empreintes laissées dans le sol par les racines et les bases des tiges des palmiers sont trouvées lors de fouilles archéologiques récentes. Ces racines, cylindriques et non ramifiées, parfois de l’épaisseur d’un petit doigt, laissent en se désagrégeant un vide de section circulaire dans le sol. Comme elles naissent toutes de la base du palmier, à l’endroit où celui-ci a disparu, on a une concentration de trous circulaires de même diamètre et une dépression circulaire due à la forme de la base du palmier.
Mais les pollens et les empreintes de racines ne sont pas assez caractéristiques, seuls les endocarpes vides et abîmés de fruits retrouvés dans des cavités sur le site Ana Okeke sur la péninsule de Poike ont servi à décrire ce genre et cette espèce. Ces fruits, qui ressemblent à des noix de coco miniatures, rattachent sans difficulté le palmier de Rapa Nui à la tribu des Cocoseae dans la grande famille des Arecacées, comme le Jubaea, mais ils sont subtilement différents des fruits de ce dernier. N’ayant aucun autre reste à se mettre sous la loupe (pas même une empreinte de feuille) il a fallu se résoudre à créer un nouveau genre, et le palmier de Rapa Nui a été nommé Paschalococos disperta par J. Dransfield en 1983.
Comment le palmier a t-il colonisé l’île ?

Lorsque l’activité volcanique de l’Île de Pâques se calme, le relief des terres émergées présente de nombreux milieux différents. Les vents océaniques apportent des îles et continents proches (à plus de 2 000 km, cependant) des spores de champignons, lichens, mousses et fougères. Ces organismes vont recouvrir les roches volcaniques et, par leur décomposition, permettre la constitution d’une couche de sol nutritive. Un processus de colonisation végétale s’enclenche, qui va prendre plusieurs centaines d’années. Peu à peu, des plantes à fleurs aux graines légères, elles aussi apportées par les vents, vont s’établir et à leur tour enrichir le sol, donner à l’horizon superficiel une texture et une structure permettant la germination de plantes plus exigeantes.
Lorsque des végétaux ligneux rampants, buissonnants ou sarmenteux/lianescents s’implantent, leur développement aérien freine l’érosion éolienne et permet la rétention d’eau avec la formation de micro-habitats.
La vie animale elle aussi s’introduit : les arthropodes tout d’abord, petits et légers, peuvent eux aussi être apportés par les vents depuis les terres les plus proches. Les oiseaux marins, à leur tour, colonisent l’intérieur de l’île pour y construire leurs nids, trouver des ressources ou simplement se reposer pendant leurs déplacements. Leurs fientes enrichissent en azote les sols de l’île. Seuls restent absents les mammifères terrestres à cause de l’éloignement du continent américain et des îles polynésiennes.
L’île est aussi colonisée grâce aux courants : dans cette région du monde, ceux-ci sont constants et puissants. Venant du Sud, le courant froid de Humboldt longe la côte Ouest de l’Amérique du Sud. Sur les côtes chiliennes, il récupère tous les débris végétaux jetés dans ses eaux par les rivières qui dévalent les contreforts de la cordillère des Andes.
Branches, lianes, et feuilles s’agglomèrent et s’imbriquent entre elles pour former de véritables radeaux végétaux, sur lesquels fruits, graines et petits animaux se retrouvent piégés et emportés en mer. Certains de ces radeaux peuvent mesurer plusieurs centaines de mètres carrés.
Ils sont ballottés par la houle et poursuivent leur dérive au gré du courant : après avoir longé la côte américaine jusqu’à la hauteur du Pérou, le courant de Humboldt se transforme en courant tropical et s’éloigne vers l’Ouest pour rejoindre le courant équatorial sud dont un mouvement continue vers l’Ouest et le Nord et un autre bifurque vers le Sud en un mouvement de retour vers l’Amérique du Sud. Tout le vivant d’origine terrestre embarqué sur ces radeaux de fortune doit endurer l’eau, le sel, l’ardeur des rayons solaires, la prédation marine… Les animaux dépérissent peu à peu, et la viabilité des boutures et des graines ne dure, en général, pas longtemps ; la plupart coulent ou se désagrègent.
D’autres, cependant, bien équipés pour les longs voyages, résistent à ce transport. Parmi eux, les fruits d’un grand palmier endémique de la côte Sud-Ouest américaine. Ce palmier est fréquent le long des rios près des côtes. Plusieurs dizaines de millions de palmiers sont alors présents dans ce qui deviendra le Chili. Le fruit, débarrassé de sa mince partie charnue ressemble à une mini noix de coco de 2,5 cm de diamètre. Extrêmement solide, cette enveloppe est impossible à casser à main nue. Grâce à la présence d’air prisonnier à l’intérieur de l’endocarpe, sa flottabilité est excellente. Après 4 mois passés dans l’eau de mer, 20 % des fruits flottent encore et la plupart des graines sont encore viables !
Il persistera toujours une interrogation sur l’origine du palmier de Rapa Nui, mais l’hypothèse la plus vraisemblable reste donc l’échouage sur les côtes de l’île des fruits du palmier du Chili. Une fois sur la plage, ces graines ont pu être transportées à l’intérieur de l’île par des oiseaux pour une raison ou une autre (nourriture, ornementation des nids, curiosité). Celles qui se sont trouvées dans des endroits propices ont pu germer et plus tard, coloniser toute l’île.
Les sols fertiles de l’île et l’ambiance climatique particulière ont ensuite façonné l’évolution de ce palmier vers une morphologie et une phénologie propre à cette population devenue insulaire et qui a évolué pendant des dizaines de milliers d’années indépendamment de son parent continental.

Arrivée des Polynésiens
Au vu de l’immensité de l’Océan Pacifique et de la distance qui sépare la Polynésie de Rapa Nui, on peut estimer que toucher terre à cet endroit est un sacré coup de chance. Cependant, les populations polynésiennes sont arrivées sur l’île grâce à une grande connaissance de la navigation et à la fabrication d’embarcations très perfectionnées. Ces grandes pirogues, à balancier ou à double coque, comprennent l’habitat et transportent aussi de quoi subvenir aux besoins d’un long voyage. Elles permettent aussi de maintenir en vie plantes et animaux domestiques qui serviront de ressources connues sur des terres qui ne le sont pas. C’est ainsi que ces navigateurs apportent sur Rapa Nui, entre autres, le coq et le rat de Polynésie.
Rapa Nui est alors couverte d’une forêt dominée par les palmiers, l’eau douce ne manque pas, les eaux sont poissonneuses, les sols sont fertiles mais aucun mammifère ni oiseau terrestre n’est présent. L’installation des Polynésiens s’accompagne d’un défrichage limité aux alentours du ou des villages pendant les premières décennies. Les premières cultures se font au pied et à l’abri des palmiers. Ceux-ci sont utilisés comme bois de feu et bois d’œuvre en raison de leur abondance et leurs feuilles servent aussi à confectionner les couvertures des habitats.
Le palmier de Rapa Nui, dont les noix sont comestibles, nutritives, est aussi probablement une source de nourriture. On consomme sans doute également son méristème apical (le cœur de palmier), ainsi que sa sève sucrée. À cette fin, on abat le palmier. Or ce palmier ne drageonne pas et, une fois sa tige unique coupée, il ne repousse pas.
Avec le temps, la colonie prospère, la démographie augmente et avec elle les besoins. La demande en bois de feu est de plus en plus importante tout comme l’utilisation du bois pour la construction de nouveaux habitats, de nouvelles pirogues et dans la réalisation et la mise en place de nombreuses statues. L’agriculture colonise petit à petit toutes les parties de l’île et les nutriments contenus dans les sols peu évolués (d’origine volcanique) se font de plus en plus rares ; l’érosion par les pluies et le vent sur ces sols mis à nus commence son travail de sape. Il faut alors l’enrichir en creusant des fosses de culture où l’on dépose les restes de la combustion des troncs et feuilles de palmiers principalement. Des fouilles récentes sur la péninsule de Poike, ont mis en évidence, sur un transect de 100 m de longueur, de nombreux trous de cultures enrichis avec des cendres et charbons. Sur ce même transect la présence de 29 bases de palmiers de différentes tailles donne une idée de la densité « spontanée » de l’espèce.
Au paroxysme de l’activité agricole la forêt de palmiers n’existe certainement plus et seuls persistent quelques bosquets et individus épars. Les fouilles archéologiques mettent en évidence la raréfaction des charbons de bois à la fin du XVIIe siècle, ce qui indique la fin de cette ressource. Le palmier pascuan n’est plus utilisé comme bois de feu, ce sont les graminées, désormais abondantes, qui servent à entretenir le foyer. Il est logique alors de penser que la culture du palmier, seul véritable matériau ligneux de l’île, devient une nécessité. Les fouilles montrent que le palmier a été très certainement planté et entretenu, peut-être même protégé puisqu’un site au moins présente un dallage autour des restes de bases de palmiers, un peu à la manière de ce qui se fait aujourd’hui, par exemple, autour des figuiers sacrés au Sri Lanka.
Cette dernière découverte signifie que le palmier était sans nul doute d’une grande importance pour le peuple de Rapa Nui. Cela signifie aussi que la mise en culture et la protection n’ont pas suffit à préserver l’existence du palmier et que le facteur humain actif n’est pas seul en cause dans sa disparition totale.
La disparition du palmier de Rapa Nui
La présence de pollens de palmiers dans les sédiments se tarit à partir de la couche qui matérialise la première moitié du XVIIe siècle.
Pourquoi le palmier a-t-il complètement disparu de l’île ? On ne peut qu’émettre des suppositions puisqu’il n’est resté ni écrit ni parole pour l’expliquer, mais l’on peut affirmer qu’elle est le résultat d’un ensemble de causes plus ou moins importantes.
La pression humaine a soumis la végétation de l’île à l’influence tragique de deux facteurs induits : l’érosion, tout d’abord, qui ne trouve plus d’obstacles et lessive la couche nutritive des sols de l’île en entraînant tout un cortège de fonge et de faune nécessaires à la germination et à la croissance des espèces arborées qui, désormais, se ressèment difficilement. Le rat polynésien ensuite, espèce omnivore qui se multiplie très vite et exploite toutes les ressources du milieu. Ces rats vont notamment dévorer les fruits et plantules des palmiers et empêcher, eux aussi, la régénération naturelle. De nombreux restes de fruits vides à l’endocarpe rongé ont été trouvés dans différentes cavernes de l’île où les rats entreposaient certainement leur butin. Paradoxalement, sur le continent américain, le palmier du Chili, dont dérive le palmier de Rapa Nui, a une germination qui peut être favorisée par la prédation de rats qui, en ébréchant l’endocarpe très dur, permettent à la graine de recevoir ses signaux de germination. On peut donc imaginer que la ressource sur l’Île de Pâques a aussi diminué pour les rats qui ont alors mangé systématiquement toutes les graines de palmier (y compris encore sur l’arbre).
Des traces d’incendies, qui ont eu lieu sur la péninsule de Poike entre 1300 et 1450, indiquent aussi un impact néfaste sur cette végétation fragile. Avant l’arrivée de l’humain, aucune trace de feu sur l’île n’est attestée. On peut donc dire que ces feux, volontaires ou accidentels, sont bien dus aux nouveaux habitants.
Certainement monoïque comme son parent américain, le palmier de Rapa Nui nécessite un vecteur de pollinisation.
Dans le cas des palmiers, ce sont souvent les hyménoptères qui jouent ce rôle. N’ayant plus suffisamment de ressources disponibles, ceux-ci ont aussi pu décliner, rendant la pollinisation des fleurs du palmier aléatoire et entraînant une chute dans la production des fruits.

Le palmier de Rapa Nui, dont la croissance est lente et la maturité sexuelle tardive (son équivalent chilien ne donne ses premières fleurs qu’au bout d’une cinquantaine d’années), ne persiste alors plus qu’à travers quelques individus dispersés sur l’île. Or, dans son emploi comme matériau les vieux individus sont les plus intéressants, ceux qui justement sont en capacité de se reproduire…
Enfin, des changements climatiques importants, survenus avant l’arrivée des Européens, avec des épisodes de sécheresse prolongée et d’autres périodes plus humides, ont aussi du participer à fragiliser une forêt déjà bien entamée.
Privés de l’ambiance humide et ombragée du milieu forestier, privés aussi de tout un cortège de micro-organismes du sol certainement indispensables à leur bonne santé, et malgré les efforts de culture du peuple de Rapa Nui, les derniers palmiers dépérissent probablement dans la seconde moitié du XVIIe siècle.
Aujourd’hui, plus de 300 ans après cette disparition, la perte du sol original et fertile de l’île empêche tout rétablissement du paysage boisé dominé par une palmeraie qui serait issue d’une espèce proche du palmier de Rapa Nui. Bien que rare, le flux de graines en provenance de la côte sud-ouest américaine ne s’est sans doute jamais tari… jusqu’à ce que le Chili, colonisé à son tour par les Européens, soit lui aussi déboisé de ses palmiers jusqu’à un point critique. Aujourd’hui, le palmier du Chili est une espèce protégée dont les populations sont toujours fragiles. Sur Rapa Nui, dans les essais de plantations du palmier du Chili ou dans ceux du cocotier, la dynamique de végétation ne montre pas les signes d’une reconquête spontanée du milieu. À l’heure actuelle, l’absence de matériel génétique préservé dans les enveloppes de grains de pollen et les enveloppes des fruits ne permet pas la résurrection du palmier de Rapa Nui.
La disparition d’une forêt entière d’un genre unique de palmier, certainement d’aspect remarquable si on le compare à la beauté du palmier du Chili, est bien triste pour le peuple de Rapa Nui et pour l’humanité qui a perdu une espèce végétale et à tout jamais la possibilité d’observer ce paysage d’une immense forêt de palmiers.
Les collections de fruits et graines du muséum de Toulouse préservent quelques-uns des endocarpes du palmier disparu de Rapa Nui ainsi que les fruits du palmier du Chili et de nombreux fruits de palmiers originaires de différentes régions du globe.
Photo d’en-tête : Graines de palmier de Rapa Nui (Paschalococos disperta) – coll. muséum, MHNT.BOT.2017.31.1, photo. : Roger Culos, projet Phoebus